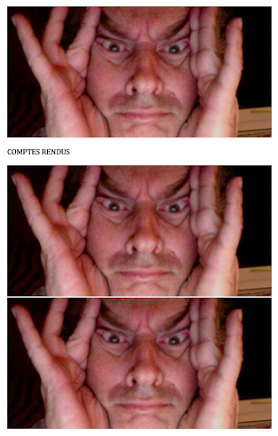Globalisation de l’art et expérience esthétique
(l’attention « distribuée »)
Bence Nanay, L’esthétique, une philosophie de la perception, Presses Universitaires de Rennes, Collection Æsthetica, traduction Jacques Morizot, 2021, 231 pages, 22 euros. (L’ouvrage a paru en 2016 aux presses de l’université d’Oxford).
Bien informé, proche des bonnes perspectives, ce livre traite de la perception au premier chef, telle qu’elle est étudiée aujourd’hui (dans la philosophie de l’esprit), et de la perception esthétique à partir d’une segmentation de certains des sujets qui concernent la première. Comment conserver une distinction entre les deux domaines : page 20, l’A. nous avertit sans ambages que la philosophie de l’art est une sorte de terra incognita où il ne voudrait pas pénétrer (« J’essaierai d’en dire aussi peu que possible au sujet de la philosophie de l’art », p.24). On obtient une variété de thèmes rangés par rubriques : l’attention distribuée, les images, les propriétés pertinentes du point de vue esthétique, le semi-formalisme, l’unicité, l’histoire de la vision, l’attention non-distribuée. Le livre est publié dans le format presque carré de la collection qui contrarie les routines visuelles et allonge le texte en l’alentissant comme dans un travelling. Il y a 4 figures, dont une seule illustre un tableau de Paul Klee. L’écriture est souple et claire, mais l’ouvrage se veut savant, et use de concepts parfois hétérodoxes (celui de triple vision, celui du « semi-formalisme », celui de l’asymétrie épistémique). Une très abondante bibliographie montre l’ampleur du problème considéré. Les exemples cinématographiques semblent indiquer quelque connaissance du sujet. L’auteur enseigne à Anvers dans le département de psychologie et s’est fait d’abord connaître par un livre sur Quentin Tarantino.
Le domaine de l’esthétique
L’intérêt d’un tel ouvrage est qu’il est transversal. Sa faiblesse est que pour faire simple, il est souvent alambiqué. Beaucoup de grandes questions sont soulevées. Celle de l’attention s’annonce, de fait, au centre du propos et justifie (estime l’A.) qu’on doive la retenir à l’encontre de toute abstraction, et même à l’encontre des ruptures qu’impose l’art conceptuel, où je pense qu’un examen moins rapide aurait pu éclaircir les choses. Il appuie sur cette fonction de l’attention une abstention radicale du champ philosophique traditionnellement affecté à l’art, qu’il appuie sur les préventions méthodologiques de Stephen Davies, ou sur d’autres affirmations plus radicales de Noël Carroll. On lit page 15 :
Une méthode simple et terre à terre pour délimiter le domaine de l’esthétique est de considérer qu’il est la somme complète des sujets où nous faisons usage du terme « esthétique ». Ceci inclurait (sans bien sûr s’y limiter) des débats sur les expériences esthétiques, les attitudes esthétiques, l’attention esthétique, le jugement esthétique, la valeur esthétique, la posture esthétique. Mais nous devrions y inclure ces débats très présents dans les revues et livres d’esthétique et qui ne portent pas à strictement parler (ou pas nécessairement) sur l’art). Ceci inclurait (encore une fois sans s’y limiter) des questions relatives à la perception de l’image et des questions sur la dépiction en général (puisque toutes les images ne sont pas de l’art), des questions sur notre engagement dans des récits et sur les récits en général (tous les récits ne sont pas de l’art), sur la fiction et les manières de s’y engager (toutes les fictions ne sont pas de l’art), sur la métaphore, l’humour, la créativité, etc.
« Ce qui n’est pas de l’art » sert de leitmotiv pour justifier de cette option libérale et même ultra-libérale de l’esthétique dont l’extension deviendrait nécessairement globale.
On pourrait délimiter autrement le domaine de l’esthétique. Mais Nanay a raison, c’est pourquoi je trouve plus belle la preuve de Kalmar que celle de Henkin, qui prouvent la même chose. C’est pourquoi les diagrammes du Tractatus sont des pictions et non pas des dépictions. C’est pourquoi les socles des statues, qui ne font pas partie de la statue, sont souvent remarquables et essentiels à notre compréhension. C’est pourquoi les dessins et les relevés en coupe de Viollet-le-Duc ne sont pas des œuvres d’art, etc. — Il y a même d’autres réticences que j’estime justes et qu’il faudrait affiner, en dépit de quelques expériences de pensée un peu bizarres (telle celle-ci, qui fait un peu froid dans le dos : se servir d’une pièce de Giacometti pour se défendre d’un agresseur qui viendrait perturber mon étonnement devant la taille des pieds de la statue : ce serait requérir mon attention, la divertir ou l’inverser, en sorte que je me verrais devoir utiliser la pièce sculptée et m’en servir comme une arme en défense contre mon agresseur, p.40).
Revenons à notre sujet. Ces réserves s’appliquent entre autres à deux énoncés importants qui sont mis sur la sellette, puis mis en doute et finalement dénoncés au chapitre IV :
1/ l’expérience esthétique est l’expérience des propriétés esthétiques,
2/ le jugement esthétique consiste à juger des propriétés esthétiques.
En pratique en effet, ni le jugement, ni l’expérience, ne se fondent sur des propriétés repérables dignes d’une expérienciation quelconque. Quand j’ai une expérience esthétique, c’est pratiquement une forme inversée d’hallucinose, semblable à celle du « goût du jaune d’œuf » dont se souvient un patient au sortir du coma, comme en a parlé Stanislas Dehaene (Le code la conscience, Odile Jacob, 2013). Il n’y pas forcément d’arrière-plan, dans ce genre de certification immédiate, et bien des expériences de ce genre ont un côté subliminal et soudain. Mais il faut prendre un exemple plus sérieux d’attention consciente pour commencer.
Si je regarde le tableau de Courbet, bien moins connu que d’autres : L’aumône d’un mendiant à Ornans (Collection W.Burrell, Glasgow), où un mendiant coiffé d’un chapeau haut-de-forme élimé donne une pièce à un enfant, faisant un geste de grand écart, je suis sensuellement frappé par la distribution de ce très grand tableau (210 cms X 155 cms), sa géométrie, son mouvement : il faut plusieurs étapes pour distinguer en saccades l’œil rapace du mendiant, ou l’ombre du pouce sur le visage de l’enfant. Mais, les propriétés lumineuses ne sont pas le sujet, ni les propriétés de texture, ni l’art du pinceau. C’est le type de démonstration qui me fait de l’épate et flatte mon intelligence du sujet. Certaines œuvres d’art apportent une connaissance qui ne doit rien au pittoresque de la scène. D’autres appellent à une sorte de recueillement (je stationne un instant sans rien savoir de la raison qui me fait m’arrêter) : mon activité corticale est saturée par trop d’informations que je ne peux traiter d’un coup. L’attention esthétique, si elle était une forme d’attention aussi fugace, pourrait également être pensée, à la limite, comme une sorte de raptus : un emportement, sinon un transport, qui ne dure que quelques millisecondes, comme si le foyer de l’attention se dérobait lui-même à son appréhension. Ainsi que l’a montré en France Jean-Marie Schaeffer l’attention est alors « sans tâche assignée » : ne restent en discussion que des propriétés relationnelles, qu’elles soient « littéralement exemplifiées » (l’unité, la cohérence), ou « métaphoriquement exemplifiées » (élégance, vivacité, calme, simplicité). Cependant ces mêmes propriétés peuvent m’être suscitées dans bien d’autres occasions et non pas uniquement devant des œuvres d’art (L’expérience esthétique, Gallimard, 2015, pp. 170-171, 174).
Les propriétés esthétiques me sont donc inconnues, si je suis l’argument de ce livre : elles ne participent pas de mon expérience, du moins directement. De même pour le jugement que je porte : un simulacre artificieux et très finement élaboré ne me permet pas de juger de sa réalisation. Je prendrai de suite un autre exemple, celui de la splendide salière de Benvenuto Cellini (1543) offerte à François 1er et récupérée après sa défaite (sur socle d’ébène avec un décor en émail luxuriant), que je vois par hasard, exposée sur une table au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Je ne peux pas juger de la maîtrise d’orfèvrerie, et ainsi je ne juge pasde ses « propriétés » au sens strict du mot, puisque j’ignore tout de leur réalité métallique ainsi façonnée : la pièce ovale (26 cms) est en or massif. S’il y a des propriétés formelles, dans ce couple de divinités ainsi alanguies, Neptune et Cybèle, elles ne sauraient être des attributs indépendants des procédés de fonderie utilisés. Seul le trident laissant la place pour le passage de la main me fait vibrer, alors qu’une petite barque attenante permettait de pincer le sel ; je sens le piquant de la chose. Dans ce cas, c’est l’intérêt pour la pièce qui manque : on a devant nous une pièce de prix qui est aussi politique. La grande discussion sur le désintéressement est d’ailleurs impliquée et en même temps évaporée dans ce livre-ci : pour Kant, le jugement esthétique est désintéressé, mais son objet réel est le sentiment de plaisir (Gefühl), non pas exactement ce qui est agréable à voir ou bien fait. Or, on ne peut pas dire que la Saliera procure un plaisir particulier dans son observation : elle fut sans doute admirée pour son exécution et son eschaton — qui est hors du commun par la richesse des finitions et des enjolivements maniéristes —, mais elle ne suscite pas une capture de l’attention à cause de la finesse des détails qui l’épuisent. La pièce est bien trop documentée pour que le focus de l’attention n’en soit pas distrait.
Le problème vient de ce que les propriétés qu’un objet « a » dépendent d’un cadre ontologique et non de sa signalétique ou du fonctionnement de l’objet comme il se dit communément. Coco Chanel utilisait des faux bijoux pour des vrais, parce qu’ils étaient plus portables, plus fonctionnels en quelque façon. Eh bien, de la même manière, on ne peut pas porter des propriétés en bandoulière (avoir des attributions épistémiques et remarquer des propriétés esthétiques dites « survenantes »), mais garder des écailles sur les yeux le restant du temps. Les philosophes de l’esthétique injectent des propriétés en lieu et place des qualités, mais ils ne sont pas les seuls. Cette mauvaise habitude dérive de l’erreur sémantique supposant une propriété qu’un objet est supposé « avoir ». Je reviens là-dessus très bientôt.
Désintéressement ou intérêt distribué
Alors pourquoi l’attention serait-elle plus discriminante ? Il n’y a pas de doute que les travaux de S. Palmer (Vision Science, MIT Press, 1999) et de J. Prinz (The Conscious Brain, Oxford UP, 2012), sont percutants, mais ils ne tirent pas vraiment de conséquences esthétiques. S’agit-il uniquement d’avancer que, disons en général, la perception a du rapport avec l’esthétique, et que, dans les travaux sur la perception typiquement, les phénomènes attentionnels sont les plus étudiés ? C’est entendu. Dans cet ordre d’idées néanmoins, je ne généraliserai pas, comme ici, l’idée que la perception et l’imagination sensorielle ont une phénoménologie très semblable, à cause de la seule ressemblance de leurs activations corticales L’explication me paraît courte (de quelle ressemblance parlons-nous ?). La prudence de l’A. qui écrit :
Je n’affirme pas que les expériences esthétiques sont nécessairement perceptuelles ou qu’on ne peut faire une expérience esthétique que d’entités qui sont perceptibles (p.28).
me convient tout à fait. J’accepte avec lui que l’attention soit partie prenante de l’expérience esthétique, en tant que « mobilisée » : — qu’elle soit « ciblée » et/ou « distribuée » est une autre affaire. Ce livre propose donc plusieurs variantes du problème, à commencer par celui du désintéressement. L’A. prend le risque théorique de relier cette question à la notion d’attention distribuée, mais commence par décrire l’effet de rémanence à l’opposé du frissonmomentané ou de la réaction psychosomatique, sans doute pour se défaire de l’illusion d’un genre d’absorption ou de posture que G. Dickie avait démystifiée et qui, en effet, est rappelée par tous ceux qui s’occupent de chercher à définir ce qu’est une « expérience esthétique ». — Au demeurant, pourquoi ne pas se référer alors à des auteurs comme Santayana, Felibien, ou Witasek (l’élève de Meinong) afin de mieux identifier ce plaisir expérienciel et bien moins organique qui est au centre du contact avec quelque chose qui provoque en nous une satisfaction déterminée ? Santayana traite d’une « occurrence » perceptive ; Felibien d’une sorte d’accomplissement cognitif qu’une belle réalisation suscite ; Witasek d’une norme d’appréciation face un objet idéal mais inactuel (une objectité) que j’appréhende indépendamment de sa matérialisation. Voyons comment la chose est envisagée tout autrement ici à partir du concept assez révélateur d’intérêt distribué (p.37)
Plus généralement, on pourrait soutenir que les expériences esthétiques ont souvent beaucoup à voir avec l’unité formelle : prendre l’œuvre d’art (ou tout ce qui donne lieu à une expérience esthétique) comme un tout unique et intégré. Cela ne comporterait-il pas une attention ciblée et non pas distribuée ? Je pense que non. Une telle manière de penser au sujet des expériences esthétiques est parfaitement compatible avec mon approche. Souvenez-vous que l’attention esthétique est ciblée en ce qui concerne l’objet et distribuée en ce qui concerne les propriétés. D’après moi, ceci décrit les traits de l’expérience esthétique dont parle Beardsley : nous prêtons attention au tout unique, unifié et intégré, de l’objet perceptuel, et notre attention est donc ciblée en ce qui concerne l’objet perceptuel. Mais en même temps notre attention est distribuée en ce qui concerne les propriétés de cet objet perceptuel, c’est-à-dire les différents aspects de ce tout intégré et les différentes manières dont ils contribuent à en faire un tout intégré. Pour être en mesure d’apprécier l’unité et le degré d’intégration de ce dont nous faisons l’expérience esthétiquement, il nous faut mobiliser notre attention sur un mode ciblé (en ce qui concerne les objets) et en même temps distribué (en ce qui concerne les propriétés), bref nous avons besoin d’attention esthétique (p.40).
Déréalisation de l’objet peint
Comme il apparaît ci-dessus, l’objet auquel on prête attention peut jouer un rôle ambivalent : est-ce l’objet-tableau, l’objet-motif (comme on parle d’un thème en musique ou du sujet d’une peinture) : c’est-à-dire un contenu non verbal ; ou est-ce l’objet du plaisir qui accompagne l’attention et la motive (le Wohlgefallen de Kant) : ce qui plaît et auquel je préfère me rapporter, même si je dois rectifier pour cela tous les biais cognitifs imaginables ?
La dualité objet/propriété conduit en réalité à l’aporie de cette distinction d’une attention qui serait ou focalisée ou diffuse (et donc multipliée), comme le texte cité l’indique. L’A. lui-même le laisse entendre : cette opposition n’est pas tenable. Quelque chose nous heurte, en effet, dans une attribution qui intéresse la présence de propriétés possédées et disjointes (même si le disjonctivisme n’est pas évoqué vraiment). Ce qui signifierait que certaines pourraient ne pas être « d’objet » (des propriétés d’objet), et que l’objet n’en serait un qu’en tant qu’il se tiendrait tel le support inerte de ces dernières — en d’autres termes, il ne serait plus l’objet d’un acte perceptif proprement dit, et les propriétés seraient flottantes en servant d’habillage circonstanciel. La fiction selon laquelle il suffirait de poser des propriétés qu’il possède pour poser l’objet est devenue extrêmement commune, comme celle qui soutient qu’il suffit de poser la représentation pour encoder l’information. Dans notre cas, l’attention, en principe sélective, pour l’A. ne l’est aucunement : elle jouerait plutôt le rôle d’une approche qu’on devrait naturaliser et, de certaine façon, anesthésier par cela même. Il y a plusieurs milliers d’articles scientifiques consacrés à cette notion d’une « tâche » attentionnelle. Vouloir instaurer une « segrégation » esthétique déguisée, obéirait dans ce cas à une expertise tout arbitraire, qu’elle soit optique et auditive. Au sens philosophique, le constat déflationniste sous-jacent face à toute forme d’appréhension de la beauté — laquelle on ne peut « expérimenter », je confirme bien — est alors remplacée par la saisie des directions imputables à ce que l’anglais appelle goal-directnedness. Ce sont bien ces directions qui servent de relata aux propriétés « détectables », et non plus délectables comme le voulait Poussin. Voir un tout, entendre un complexe mélodique, selon ce vocabulaire un peu industriel et sécuritaire, ce serait pouvoir d’abord assurer cette détection et la « contrôler ». Le contrôle en retour suffirait à cerner de quel genre d’expérience il s’agit. Dans cette approche, il arrive qu’on puisse permuter, selon moi, le niveau esthésique de l’input sensoriel, en montée, et le niveau perceptuel reconstruit en descente. Mais surtout on s’étonne du fading, de l’appauvrissement ou de la fugacité de l’expérience esthétique que nous serions censés pouvoir reproduire et ré-éprouver hors du musée et après le concert. Il n’est donc pas étonnant que cette absence de contrôle (que l’A. déplore d’avoir à éprouver, à plusieurs moments), et ce défaut d’une nécessité hédonique que l’œuvre devrait nous fournir, deviennent alors lui aussi un objet d’étude et d’évaluation. Mais la nature des valences positives ou négatives dans une théorie évaluative, est encore un problème séparé ; il ne peut servir de remplacement face à l’émotion provoquée qui pourrait être contrariée ou réprimée, en première intention, comme si un avertissement intérieur me disait « stoppe ou continue » d’éprouver cette émotion (devant une chose horrible, une monstruosité, une joliesse hideuse). L’idée même, reprise de Noel Carroll, d’un déflationnisme de cette expérience émotionnelle coïncide avec la surcharge de l’« intérêt » attentionnel porté à la seule « détection », ici déplacée du niveau neurologique vers une application aux phénomènes esthétiques.
Car toute cette affaire est dépendante est l’inattentional Blindnessde A. Mack et I. Rock (1998), qui a fait autant de dégâts que les neurones-miroirs de Rizzolati : la distribution de l’attention est empiriquement observable, et correspond tout bonnement à une syncope éventuelle — une information que je ne perçois pas — un genre de distraction positive très finement artificialisée en laboratoire ; elle se trouve adaptée à l’étude des images (ici au chapitre III). A l’inverse de ce point de vue, Robert Hopkins (2010) avait pour sa part forgé le concept d’inflexion pour caractériser les images dotées d’un rôle esthétique : entendons qui possèderaient des « propriétés » modificatrices de la seule surface du tableau, dès lors que l’objet dépeint se trouve envisagé ou scénographié « dans » une image. En clair, ce qui est vu séparément par l’effet d’une image : son design ou son contour, ne se confond pas avec la scène qu’elle représente (scene). Le design infléchit la représentation mentale de la scène et ne la réfléchit pas. Nanay corrige en objectant que cette mise en présence opère plutôt par une sorte de déréalisation de l’objet peint : le voilà désormais non plus ciblé, mais identifié par une attention « distribuée » (l’aporie que je soulignais plus haut), or la saisie, contractée pour lui en une propriété double (design-scene-property) est assez différente comme l’indique le passage ci-dessous :
On caractérise souvent l’appréciation esthétique des images comme l’appréciation des images en tant qu’images. L’appréciation esthétique des images est clairement une sous-catégorie de la perception d’images. Ce ne sont pas tous les cas de perception d’images qui comptent comme appréciation esthétique de l’image perçue. Le plus souvent en fait dans la grande majorité des cas, nous voyons quelque chose dans une image, mais nous n’appréciation pas l’image de façon esthétique, nous n’apprécions pas l’image en tant qu’image. (…) On peut apprécier ce qui est dépeint dans une image sans apprécier l’image en tant qu’image. Il y a donc vraiment deux questions différentes concernant la perception d’image : que se passe-t-il dans notre esprit lorsque nous voyons des choses dans des images et que se passe-t-il dans notre esprit quand nous voyons des images de manière à les apprécier aussi de façon esthétique ? (…)
Comment est-il alors possible que tant un Gombrich qu’un Wollheim semblent avoir donné la même réponse à ces questions ? Etaient-ils confus au point d’échouer à faire cette distinction toute simple ? Ou bien avaient-ils une intellectualité si forte qu’ils étaient dans l’incapacité de regarder des images sans les apprécier de façon esthétique (sic) ? (…) Richard Wollheim considérait que voir la surface de l’image et l’objet dépeint simultanement est un trait crucial à la fois de l’image en général et de l’appréciation esthétique des images. Encore une fois, pour que ceci n’engendre pas de paradoxe, il fallait que par « voir » il ait voulu dire des choses différentes dans voir la surface et l’objet dépeint simultanément lorsqu’il aborde les deux questions. Et nous pouvons — en fait nous devrions — maintenir séparées ces deux affirmations très différentes, tant que nous nous servons du concept approprié de voir. Nous avons vu qu’une manière de rendre opératoire la proposition relative à la vision simultanée lorsqu’on en vient à comprendre la perception d’image (non l’appréciation) est de faire intervenir le concept d’attention et de soutenir que, bien nous voyions simultanément la surface et la scène dépeinte, nous ne prêtons pas simultanément attention aux deux, nous ne prêtons attention qu’à la dernière (pp.58-59).
Le troisième pli
Indépendamment de la critique intéressante de Wollheim, j’aimerais savoir ce que signifie apprécier ou ne pas apprécier l’image en tant qu’image, et en quoi serait-ce au détriment de l’objet peint. Il est intéressant de noter que l’auteur passe du concept à l’entité, et remplace l’objet par la scène dépeinte. Mais la justification recherchée par lui est la détermination d’un troisième pli, puisque la double perception du seeing-in ne donne pas satisfaction et n’est pas un motif de plaisir particulier. C’est ici que les choses se corsent, puisque revient le rapport entre objet // surface peinte // scène peinte. C’est sans doute ce qui fait l’intérêt du livre sans quoi ce compte rendu serait malvenu. L’A. poursuit :
Lorsqu’on traite de la perception d’image, il nous faut considérer non pas deux mais trois entités. Ce sont les suivantes :
A. La surface bidimensionnelle de l’image
B. L’objet tridimensionnel que la surface de l’image encode visuellement
C. L’objet dépeint tridimensionnel
La nouveauté réside dans la distinction entre B et C qui ont été traités de manière interchangeable dans les écrits spécialisés. Or bien qu’ils semblent souvent semblables, ce n’est pas toujours le cas. B et C s’écartent l’un de l’autre à partir du moment où l’image n’est pas pleinement naturaliste (p.63).
L’explication qui suit envisage les trois possibilités (pp. 62-71) et s’écarte de l’identification iconique qu’a identifiée Hopkins. S’agissant de [A], Bence Nanay est correct en imaginant les vues obliques ; il est plus conjectural quand il le fonde sur le sous-système visuel dorsal, sur lequel a beaucoup insisté Marc Jeannerod. La perception angulaire en effet ne modifie pas la surface, mais — j’y insiste un peu — : l’entité-surface bi-dimensionnelle n’est pas définie sur le plan optique, ce qui est en effet très difficile. Je ne suis pas même pas sûr qu’elle existe. S’agissant de [B], le recours est fait à l’expérience de la « pomme » (quand elle est représentée) : une pomme qu’on ne mange pas, alors qu’elle peut requérir une imagerie mentale préalable à mon appréhension (un type-pomme pour un collégien de Madagascar qui n’a jamais vu de pomme réelle, et la verrait reproduite dans un livre), l’auteur préférant ici parler d’une « phénoménologie inconsciente ». L’encodage visuel est par conséquent assimilé à un genre de complétion, avec des contours qui deviennent « illusoires ». Il offre à cet égard une version plutôt sommaire, me semble-t-il, de la complétion gestaltique. C’est au niveau [C] : l’objet dépeint, qualifié de tridimensionnel, que le raisonnement est plus délicat à suivre dans ses conclusions en faveur de ce qui serait « quasi-perceptuel » et cela en vertu d’une pénétrabilité cognitive qui est débattue sur la question de savoir ce qui pourrait influer sur le cortex primaire dans une troisième dimension qui n’est alors que stipulée par rapport à ce qui est vu empiriquement. Je suis prêt toutefois à lui donner mon accord dans le cas de la sculpture, avec la réserve que le groupe de rotation du squelette humain : celui de la personne environnant la statue ou la contournant, pourrait participer de la perception de la pièce. C’est beaucoup moins vrai en ce qui concerne l’art pariétal des grottes ornées d’Altamira à Chauvet, parce que les animaux sont superposés en couches transparentes.
Il y aurait ici beaucoup d’objections à faire si j’en avais le temps. — Pour revenir en arrière très rapidement, disons tout d’abord que voir dans une image est une autre image : une image verbale d’un jeu de langage qui n’a pas d’application confirmée, y compris pour les phénomènes bi-stables. Ce que Richard Wollheim a voulu dire doit être un peu différent par un ralentissement de l’observation. L’objection principale est la suivante. D’une part, il y a bien toujours une stabilisation de l’image, en dépit des saccades discrètes qui arrivent sur la fovea (D. Melcher, 2011) : cette stabilisation est objective, corrigée automatiquement, et la subjectivité n’y participe pas ; de l’autre, la notion d’attention n’est pas séparable du fait que la direction perceptive du regard (si je regarde une montre, par ex.) bouge avant que ne bougent les yeux (P. Cavanagh, 2009). Un glissement (shift) s’effectue qui commande au nerf optique et à la correction de la parallaxe. Ces deux données : la stabilisation iconique dite en jargon spatiotopique, et même la directionnalité psychique empêchent de penser à une dissociation de l’attention prise en un sens psychologique (elle est plus dissociée, que distribuée). L’auteur lui-même le pressent quand il écrit, renversant son propos initial : « la manière dont l’attention est ciblée en ce qui concerne les propriétés, et distribuée en ce qui concerne les objets », dès que nous pouvons voir deux objets dans la même image (p.77). Si l’image est stable, c’est en vertu d’une relation interne entre B et C. — Mais un exemple trois fois repris, le portrait de Madame Matisse me semble quand même extrêmement perturbant à ce sujet.
Bence Nanay évoque l’un des tableaux de Matisse, sans le préciser, qu’il assimile à un genre de caricature où le personnage féminin (Madame Matisse) a, en effet, le visage ombré d’une couleur vert-chou ; il met alors en contraste le visage vert [B] du tableau et le visage qu’on suppose réel [C] : le visage rose de Madame Matisse pour faire entendre son propos. Dans un tel cas de figure (si j’ose dire), le tableau de Matisse oppose un démenti flagrant à cette façon de voir.
Je dois une petite remarque en passant pour expliquer mon agacement. Entre 1907 et 1909, le peintre a décalé l’extension de la surface et le bordurage du dessin : il les a surexposés à plat pour en critiquer la concurrence latérale et verticale. Les nombreux portraits de Madame Matisse l’attestent, autant que son propre portrait à lui (1907), où le même vert déborde de la figure, rendant strictement incohérente l’idée d’une décision plastique qui porterait sur la troisième dimension. Matisse déclare qu’il s’agit de ne plus appliquer la ligne noire de délimitation — une ligne ourlée et épaisse que les Fauves pratiquaient et Braque également au début, et qu’il a lui-même pratiquée. Il me paraît donc que ce type d’allusion n’éclaircit en rien l’objet de la démonstration. L’attention aux phénomènes plastiques proprement dits, est souvent suggestive de la plus contrariante des croyances.
Dès qu’on range l’expérience esthétique sous le concept d’expérience, c’est l’expérience qui prend le dessus. Ou bien on s’enfonce dans la pâte du vécu (c’est la collante Erlebnis, dont Matisse a voulu se défaire en parlant d’une expérience vécue de la couleur sans que cette expérience ne recrute un objet défini) ; ou bien on borne le dessin sans se préoccuper d’aucune profondeur, en la récusant plutôt afin de donner à la ligne une souplesse indépendante de la profondeur de champ naturelle (ce qui exemplaire chez Matisse). Mondrian a d’ailleurs fait exactement le contraire, avec ses bandes noires, mais dans le même esprit (se passer de la profondeur). Il est donc assez fâcheux que la caricature de Mick Jagger soit mise ici sur le même plan que le choix de modèles domestiques, chez Matisse, qui sont dotés d’une force propre conférée à l’expérience « artistique » par lui mise en œuvre, ruinant l’aspect fondamental de la dépiction. La défamiliarisationqu’évoque ailleurs B. Nanay se fait justement à cet endroit.
A cet égard, le développement reste un peu laborieux par les assauts de précautions de l’A., ou peut-être à cause de la parcimonie des exemples. Certains me paraissant être, je l’avoue, de faux exemples, des exemples controuvés ou de mauvais exemples, qu’on retrouve dans toute la littérature sur le sujet (les attentats de Duchamp au modèle de la Joconde, le De Kooning erased de Rauschenberg, une œuvre de R. Barry limitée à une phrase, etc. pp.129-130). D’autres sont littéraires et narratifs — Proust, Huxley, Wilde —, et sont hélas peu convaincants par leurs comptes rendus, même éloquents. Il est vrai que le sujet est aussi insondable qu’encombré. B. Nanay est à la recherche d’une forme d’attention « spéciale », comme il est dit à plusieurs reprises, je suppose : qui serait spécifiquement esthétique et qui est bien sûr introuvable. Si on exclut les connaisseurs, les experts et les savants (Lessing, A. Wartburg, Gombrich, Zeri, Belting et alii.), qui refroidissent techniquement l’expérience subjective, l’indéfinissabilité de l’empreinte perceptuelle devient encore plus palpable, puisque les vecteurs informatifs ne sont pas chargés dans cette description : ils sont déchargés d’intention et dénués du contexte social de leur production (si j’essaie de résumer l’argument présenté) ; au fond, nous serions désarmés et penauds quand nous éprouvons une telle expérience. L’A. tente plusieurs compromis : entre réalisme et anti-réalisme, entre formalisme et anti-formalisme pour essayer d’y voir plus clair. Le but étant d’échapper aux contre arguments. Je comprends plus mal, néanmoins, ce qui est appelé « semi-formalisme » dans ce livre (ch.V). « Histoire de la vision », le chapitre VII, de même, me paraît aussi quelque peu daté. — La danse du même Matisse (Musée de l’Ermitage, 1910) représente-t-elle une danse ? Oui, mais que le scandale public soit venu de la non-représentation des organes génitaux des danseurs nus, n’a aucune importance esthétique constitutive de la relation du tableau au spectateur. Les propriétés formelles sont bien en jeu dans le décorativisme abstrait de Matisse, et si la discrimination attentionnelle se reporte sur autre chose, c’est au détriment de la réalité de ces propriétés-là (à supposer qu’elles soient de même sorte que les propriétés stricto-sensu, soit des propriétés physiques : ce que croyait justement Matisse, traitant de la couleur comme une quantité, de façon non-chromatique contre les divisionnistes et les impressionnistes).
Il est par conséquent assez trivial de considérer que le contenu non-représentationnel soit « absenté » (mis entre parenthèses) dans le formalisme : à quel titre est-il non-représentationnel ? On s’étonnera que les études d’Adam Pautz et de John Zeimbekis ne soient pas même signalées ici (elles auraient servi), tandis que de très nombreuses études empiriques sont utilisées comme des données irréfutables, et que d’autres références leur soient alternativement préférées (Regis Debray, Jonathan Crary, Rosalind Krauss) qui sont depuis longtemps très contestées sur le terrain de la vision et sont devenues journalistiques.
Pertinence
Au centre du problème se creuse une distinction entre propriétés esthétiques et propriétés esthétiques pertinentes pour le mode attentionnel étudié. La thèse est que les propriétés pertinentes ne sont pas nécessairement évaluatives (p.83) : c’est une thèse importante. Méthodologiquement, le point de vue semble juste ; si on ne croit pas aux propriétés d’objet, il faut bien alors que cet objet soit dépouillé de toute objectité. Les évaluations se font sans lui ou en dehors de lui. Il est frappant néanmoins qu’un chapitre entier (le ch. IV) soit consacré à la notion de pertinence, au sens phénoménologique (ce qui fait une différence dans mon expérience), puis au sens perceptuel (la perception même des propriétés pertinentes). Est-ce que cela fait avancer le débat ? Bence Nanay prend conscience de ce qu’il appelle « l’artillerie lourde », au chapitre VI quand il aborde la question des tropes. Avant cela, il pose à nouveau ces questions qui entortillent le statut des propriétés, seule façon selon lui de qualifier l’attitude attentionnelle. Sont-elles du type : « être triangulaire », « avoir une valeur sentimentale de souvenir », ou bien « être équilibré » ? et doit-on se demander « comment sont-elles attribuées ? ». On sait que Sibley a démontré assez clairement que les prédicats valent pour des propriétés, sans que leur appartenance à l’œuvre d’art ne soit en rien projectible, et sans trancher la question des propriétés attributives (qui n’ont pas la même logique) ; enfin, sans que nous dussions intégrer les propriétés esthétiques pertinentes dans le champ des propriétés perçues. Si Bence Nanay se défend de mener une « croisade contre » les propriétés (p. 84), il mène bien ensuite une croisade contre les tropes (pp.140-141), qu’il accuse à la fois d’être des propriétés « simples » et répétitives qui en feraient telles des épiphanies de propriétés, qui seraient « attribuées » aux objets, et qu’à cause d’elles le sentiment d’unicité de l’objet serait perdu (je n’en dirais pas plus sur le sujet et la nature de ce contre-sens, parce que le sujet n’est pas là). Mais, s’il est question de pertinence, la référence aux tropes assimilables à des propriétés esthétiques ne l’est pas, parce que l’enjeu mouvant de ce livre est de discuter du paradoxe des propriétés objectales que l’auteur ne considère jamais comme esthétiquement assignables. Ce qui se comprend pour toutes les formes qu’il appelle « naturalistes ». D’où quelques inférences réellement incertaines. Une phrase désenchantée du livre fait penser à Adorno et à son dialectica dialecticam amat, je veux dire dans sa formulation :
Une manière dont ce programme de recherches peut décrire l’art conceptuel est qu’il s’agit d’une tentative de rendre pertinentes des propriétés qui sont apparemment dénuées de pertinence esthétique. En fait, nous pouvons même décrire l’attrait de l’art conceptuel en disant que les artistes conceptuels attirent notre attention sur des propriétés pertinentes du point de vue esthétique qui ne sont pas des propriétés esthétiques (p.91)
Outre la périphrase intéressante : l’attrait de l’art conceptuel, (qui mériterait d’être analysée), c’est en effet un problème de fond qui est considéré. L’A. est convaincu que l’échange des propriétés évaluatives (déterminables) et non-évaluatives (qui sont déterminées) se produit sur le mode qu’a interprété Frank Sibley : a/ il n’obéit pas à une préoccupation ontologique ; b/ il ne concerne pas les critères d’identification de la surdétermination critique. C’est pourquoi, écrit-il, « l’interprétation ontologique de l’affirmation d’unicité se révèle être intenable et l’interprétation particulariste qu’on en donne se révèle orthogonale à la question de l’unicité » (p.137). Ce que veut dire cette phrase obscure est que le nominalisme esthétique (pour qui, il n’y a que des œuvres particulières) s’opposerait à qui affirme que « toutes les œuvres sont uniques ». La particularité qui obligerait en quelque sorte l’attention esthétique serait incompatible avec l’unité du symbole. Par conséquent, l’œil innocent serait vicié en tant qu’organe dans la façon même qu’il a d’enregistrer, parce que notre intuition est aveugle (on se souvient ici de Nelson Goodman). Bence Nanay a peut-être raison là encore, pour renverser ce programme, de donner à suivre Frank Barkhage (1933-2003), qui filme la décomposition de son chien, les ébats d’un bébé et le spectacle ordinaire de la morgue, s’inspirant d’Isidore Isou ; ou plus poétiquement à John Ruskin faisant appel à une « perception enfantine » en 1857. Mais l’œil subjectif est devenu depuis beaucoup moins innocent que l’on a pu penser dans les années 1970 encore : la situation est renversée, puisque quand je vois innocemment une pelouse verte lors d’un match de football retransmis à la télévision, je ne vois rien de vert en particulier ou en général, et supposer que je croie en l’existence de la pelouse du terrain, dont je suis systématiquement distrait, est une hallucination infographique. Si elle était en plastique violet, cela ne ferait aucune différence. Tout le monde, dans l’intervalle, s’est habitué à la supervision des drones qui créent un genre de malaise dans la détection et qui ont pour principe de détruire l’illusion si naturelle de l’œil humain, alors que ce sentiment de voir à hauteur d’homme est biologiquement la meilleure attestation du sentiment oculaire, avec le surcroît de l’adaptation de l’œil aux réalités pénombrales. L’œil technologique certes n’est aucunement vicié, mais la question est de savoir s’il fournit de la même manière un sentiment de satisfaction.
Pénétrabilité cognitive
L’avantage paradoxal de ce livre : L’Esthétique, une philosophe de la perception est d’être une compilation réussie (en américain : a motley) disséquant les nombreux errements et revirements qu’elle recense (utilement d’ailleurs). Ce qu’on peut regretter est un excès de confiance et l’effet de catalogue de tant de références qui ne sont pas exploitées convenablement. Avec les mêmes arguments, on conclurait tout l’inverse de ce qui est proposé, et Bence Nanay y invite plus ou moins lui-même. On retiendra plusieurs choses positives : l’insistance sur « ce que nous fait une œuvre d’art la première fois » (je me souviens de la première fois où j’ai entendu Le Sacre du printemps), et l’intérêt pour l’attention dite finalement « sollicitée », dont il n’y a pas de définition cependant, enfin peut-être une partie du dernier chapitre sur l’attention distribuée au regard des œuvres de fiction et du cinéma.
Ce qui n’est pas douteux est que sa critique de l’œil innocent use et abuse de la pénétrabilité cognitive, dont je me demande souvent ce qu’implique cette dénomination : il m’avait semblé que chez Zenon Pylyshyn (l’inventeur du concept), il s’agissait de suspecter l’entrelacement des croyances neurologiquement apprêtées pour assurer une « cohérence sémantique » à ce que le stimulus informationnel nous fournit. S. Siegel (2011) a ensuite contesté cette cohérence, défendant que les contenus ne sont pas interchangeables pour deux personnes visualisant les mêmes stimuli : ce qui va justement à l’opposé de ce que l’A. appelle la « vision double » par une étrange diplopie théorique, sur laquelle il insiste tout à la fin, dans un cadre interindividuel. Dans d’autres études (Steven Gross, 2017), on insiste désormais sur le fait que le stimulus ne peut pas être brouillé, et même que les opérations qui chargent cognitivement sa réception se font souvent avant ou après, de sorte qu’il ne faut pas confondre la pénétrabilité cognitive de la perception elle-même avec la pénétration cognitive de l’attention hors de toute assignation esthétique. L’objection semble là dirimante à l’égard de l’objectif de cet ouvrage, puisque l’attention au sens épistémique n’est plus une attente justifiée, mais une attention en attente de remplissement.
Indications bibliographiques contrastives
J. Pelletier & A. Voltolini, The Pleasure of Pictures, Routledge, 2018
J. Levinson, Pursuits of Aesthetics, Oxford UP, 2016
Y-A, Bois, Painting as Model, MIT Press, 1990, nouvelle édition La peinture comme modèle, Les Presses du réel, Dijon, Genève, 2017
J.M. Schaeffer, L’expérience esthétique, Gallimard Les Essais, 2015
J.M. Schaeffer, Adieu à l’esthétique, PUF, Paris, 2000.
J. Zeimbekis & Athanasios Raftopoulos, The Cognitive Penetrability of Perception, New Perspectives, Oxford on line, 2015.
Apologue optico-sentimental
Les notes qui suivent sont réellement de pauvres notules ; elles n’ont pas beaucoup d’intérêt. Ce sont des goguettes comme écrit Voltaire sans sa correspondance. Je les donne quand même en marge de ce compte-rendu, tel un petit conte moral et spéculatif. Dans l’un des textes de Schiller, on sépare ce qui est naïf et ce qui est sentimental (Peter Szondi a bien expliqué pourquoi), face à ce qui serait un contenu esthétiquement déterminé. Et le texte du jeune Bence Nanay m’apparaît comme typiquement naïf, bien que très instruit et très documenté, ou à cause de cela peut-être.
Ces indications que je livre ici à la suite ne valent que pour un motif : la passion que j’ai des exemples et des contre-exemples et le genre de dépit que suscite en moi une naïveté un peu pompeusement assumée qui me paraît n’être qu’un genre de philistinisme méthodologique. D’abord, je ne suis pas d’avis qu’il y a des théories progressistes et d’autres dégénérescentes, comme le laisse entendre dans ce livre une suite de remarques au sujet de Lakatos. Car cette surestimation de la science en progrès qu’a dénoncée Wittgenstein ne signifie pas qu’on adopte une attitude réactionnaire ou même pseudo-scientifique. Il y a de bonnes et de mauvaises théories. Visionnons sur le motif ce qui peut le rendre cette distinction effective.
L’A. prend à un moment dans le texte, l’exemple de l’homme au turban bleu de Van Eyck, dont il se dit « hypnotisé » par le coloris du chaperon, comme si ce coloris seul était pour lui remarquable (p. 39), tout en avouant que ce ne serait pas une expérience esthétique. Choisissant ce candidat à l’appréciation apparemment au hasard, il décide de contourner le sujet aussitôt, et délaisse volontairement selon nous son alter ego pictural, non point donc le portrait de Jean de Brabant (l’homme au turban bleu, sans doute une commande), mais le portrait de l’homme au turban rouge, du même Van Eyck, plus célèbre et plus illustratif, qui a comme particularité insigne de regarder le spectateur, à la différence du premier. Tout revient à savoir pourquoi cette confrontation oculaire, presque impérieuse chez Van Eyck, a un sens pour qui la regarde. J’ai tenté d’expliquer ailleurs que ces formes d’autoportraits ou de portraits ont une allocation distincte, puisqu’ils prennent (justement) pour motif principal l’attention même du spectateur-regardeur qu’ils essayent de retenir et d’incorporer au portrait dans une confrontation muette. Qu’on me pardonne l’aspect farfelu de la chose, j’ai aussi fâcheusement tendance à considérer que le Taureau de Potter (Mauritshuis, La Haye) me regarde lui aussi, bien que j’aie aussitôt tendance à « prêter attention » à cette mouche qu’il a sur le flanc, dont parle Eugène Fromentin. Supposons que j’ignore tout de ce que voient les animaux, et que je me concentre sur ce qu’on montre que voient les animaux dans leur rapport à nous, comme le faisait Musil. Dans tous ces cas retenus, je pourrais en effet présenter un argument comparatiste, qui n’est pas présent dans ce livre, qui est que l’on peut fréquenter des œuvres d’art en les comparant, pour le plaisir de les comparer, et que cette comparaison donne à l’attention une action plus robuste. Par exemple, Le cheval Pie du même Potter (Getty Museum) est surtout significatif pour la position de l’animal dans le paysage et le contraste avec sa robe blanche tachetée de noir, etc. Le même sujet du cheval Pie peint par Potter se retrouve dans un autre tableau du Louvre où le regard de l’animal est languissant dans un ciel gris très sombre. Je vois un paysage peint derrière lui avec mes propres yeux, mais (une sorte d’infirmité chez moi ?) je ne vois nullement, serait-ce par défaut, des yeux peints de l’animal comme des yeux peints qu’on aurait isolés sur la toile — je veux dire peints séparément et rajoutés comme des yeux factices —, pour me faire voir le paysage. Je vois le paysage où l’animal est planté : autrement dit, non pas l’objet-ciblé cheval, mais le ciel derrière lui, ce qui ne se voit pas de suite, parce que l’animal ne le voit pas et nous regarde. Il ne m’est pas utile de considérer que l’attention est distribuée.
Pas besoin d’être un expert en histoire de l’art, rappelle l’auteur qui se moque un peu légèrement d’Ernst Gombrich, de son refus de l’œil innocent et de son « illusionnisme ». Je suis loin de le contester. Revenons un instant à Van Eyck pour rendre compte de cette affirmation. On ne peut feindre d’ignorer que dans le premier cas (Le turban bleu, Musée de Sibiu, Roumanie) le personnage (qu’on suppose être Jean de Brabant) tient dans sa main une bague, qui requiert son attention et qu’il la regarde, et que dans le second (L’homme au turban rouge, National Gallery), il s’agit très probablement d’un auto-portrait de Van Eyck, fermement signé, somptuaire et marquant l’époque. Si l’on se contentait de dire qu’on saute d’une couleur à l’autre, d’un chaperon à l’autre, cela n’aurait aucun sens. Forme et couleur ne sont pas forcément pertinentes en ce cas, et de fait, pour les neuro-scientistes, elles ne sont pas codées en montée par les mêmes zones corticales. Les deux tableaux sont de petits tableaux sur bois, de la taille d’une feuille de papier, et c’est leur format qui d’abord force l’attention et la contraint. Dans un second moment, c’est la nature du glacisqui s’imprime sur notre rétine. L’A. parle lui d’une surface abstraite et « comme » abstraite de l’image : une image qui serait décollée de la surface de la rétine, tout comme si on pouvait la détacher mentalement, autrement dit la voir « comme une surface ». Chose impossible d’un glacis. Ces analogies du voir comme une surface me sont conceptuellement suspectes. Il y a hélas, je sais, toujours trop de choses à dire sur la couleur et sur le surfaçage. Quand on a restauré le plafond de la Sixtine au grand dam des connaisseurs et de leur amour des sfumature, on a découvert des associations non complémentaires : un bleu et un marron, un jaune et un vert, un orange et un rose, drapant les figures et imprégnés dans les fresques : — autre surface que celle de la fresque, mate et acidifiée par la chaux, rétractée et souvent indécelable. Ajoutons aussi que le dipinto d’Alberti ne peut pas être traduit par ce qui est painterly en anglais (ce qui est peinturluré), parce qu’on ne remplit pas une surface par de la couleur. C’était la grande obsession de Morris Louis et de Barnet Newman.
Nous avons des sentiments optiques, qui sont plus ou moins bien expériencés. C’est une thèse hérétique que je défendrai. Il faut pratiquer pour cela une sorte de tunnel optique, comme disent les neuroscientistes. Les trois citrons de Zurbaran sur une coupelle en argent (le quatrième étant caché), qu’on voit dans plusieurs de ses œuvres, n’ont rien de commun avec mes grisâtres neurones (ils forcent l’observation naturelle, sans qu’il soit besoin de parler de mon expérience). Je les regarde sans pouvoir le faire comme si je faisais avec des jumelles. Je pourrais me servir d’un viseur électronique ou télémétrique pour le vérifier : sauf que mon sentiment optique ne serait pas changé. Valent-ils aussi pour me faire sentir le goût d’une citronnade dans une perception multi-modale ? J’en doute évidemment, mais il y a une conversion du palpable au visible qui n’est pas hallucinatoire. Dans ce cas particulier des natures mortes du XVIIe siècle espagnol, à cause de son sens évangélique, on voit là peut-être du vrai pain comme on n’en mangera jamais, bien cuit et sans additifs, notamment chez le premier Velasquez ou chez Pacheco. Que ces citrons soient réels ou idéalisés n’est pas la question ; que ce pain soit exemplifié analogiquement importe peu. Nous avons des sentiments optiques qu’on ne peut pas dénaturer par nos croyances. Le vrai pain n’est pas une vérité en peinture, comme aurait dit Derrida, mais une attribution de croyance qu’il faut soutenir par quelque chose. Les sentiments y participent, parce qu’ils ne font pas référence à des choses que nous connaissons déjà par d’autres moyens.
Ce n’est pas tout, cependant. J’éprouve toujours, en parallèle, les mêmes réticences à l’endroit d’une certaine école de l’expérience diaphane, dont le contenu serait si « transparent » qu’il justifierait qu’on parle de quasi-perceptions véridiques — l’expérience esthétique me semblant, au contraire, l’une des plus opaques de toutes. Ce qu’avait écrit le grand Moore à ce sujet ne vaut pas de nos expériences esthétiques qu’on dit stimulus-driven. Je revendique là-dessus un atavisme foncier dont j’espère qu’on me pardonne l’expression. Probablement, ai-je trop étudié les simulacres dans le passé — je pense aux statues décrites par Varron que Saint Augustin a vivement critiquées dans La Cité de Dieu — car le fait est que ces simulacres de la théologie physique ou institutionnelle des Romains absorbent les phantasmes les plus divers (au sens technique du mot phantasme), ne représentent rien de réel ou d’humain. De façon absolue, et surtout de façon relative. Je renvoie les lecteurs avertis au De Imaginibus de Porphyre. Le numen est l’archétype le plus ancien de la signalétique de l’attention (une statue me ferait signe quand je bouge la tête pour la regarder). Depuis la plus haute antiquité, ce n’est pas une expérience véridique du voir qui est envisagée. La querelle des images a fourvoyé plus tard la question décisive qui était posée.
Le problème de l’attention peut donc être renversé sur ses bases de départ. Je dirais spéculativement ceci.
1/ Ce n’est pas que l’attention puisse ne pas être esthétique ; il est plus conceptuel de penser qu’il n’y a pas d’attention esthétique, stricto sensu — du moins dans sa seule exclusivité individuelle, revendiquée par les amateurs, les esthètes et le public.
2/ L’œuvre d’art ne sollicite pas l’attention qu’elle réclame. Elle est indifférente au regardeur ou à celui qui écoute : on soutiendra alors qu’elle subsiste dans la perception ou pour la perception qu’elle convoque de façon épisodique, suscitant autant de fluencesqu’on voudra (j’évoque celles étudiées par Reber (1999) que Jean-Marie Schaeffer (2015) a remarquablement détaillées) : son Außersein à elle la protège de nos élucubrations ; elle « facilite », mais ne prescrit pas le type des attributions parfois sophistiquées que nous formons et qui ne sont pas directement dépendantes de l’activité du jugement. Certes nous faisons du mot « œuvre d’art » une manière de prête-nom, sans préjuger que nous l’ayons reconnue pour telle. Ce n’est pas le sujet de cet apologue. Mais, à l’encontre de certaines conséquences qui diraient que si l’attention est la seule qui soit marquée d’un caractère hédonique (puisque c’est elle qui attire le plaisir ou le déplaisir), alors elle devrait être fondée sur la structure du stimulus perceptuel, je ferai l’hypothèse que ce type de reconstruction ne peut être inscrit dans une inférence solide. Toute œuvre opère en circuit fermé pour ce qui est de sa signification : c’est d’ailleurs pourquoi on adopte le point de vue iconologique et contextuel qui fait qu’on la transfère vers un autre niveau de signification pour la comprendre. Rien n’empêche de dire (de ce point de vue) que les trois citrons de Zurbaran sont une image de la Trinité, mais le sentiment optique ne le garantit pas. Rien n’empêche de détester l’Hercule ivre du Musée de Naples et d’y voir une provocation grotesque. Mais on prête aux dieux la possibilité d’être grotesques de façon spectaculaire, contre toute décence chez un touriste du type épicurieux. Il est donc ontologiquement plausible que les œuvres soient des entités dispositionnelles, dont la manifestation esthétique, cultuelle, et même documentaire, puisse varier de façon non-linéaire, objectivement, et non pas seulement historiquement.
Comme Schaeffer, je prolonge donc l’idée que les biais attentionnels « parasitent » la relation cognitive, et cela sans aucun doute aussi en la facilitant.
3/ Pour reprendre un terme quelque peu chantourné de Findlay, cette absistence des objets d’art (qui sont apparemment du monde et catalogués dans nos réserves), est une manière de désigner ce hors-d’être qui les retire de notre attention directe. C’est cette même absistence au sein des objets ordinaires qui les rend strictement inconsommables, et subroge leur autonomie esthétique, dont on a largement discuté jadis au regard de leurs conditions de production. En rapport aux thèses de ce livre, cela n’ôte rien de leur substance aux œuvres conceptuelles du XXe siècle, qui peuvent suggérer les mêmes sentiments optiques et tactiles que nous avons indiqués, qui ne sont pas de plaisir, mais qualitativement distingués et soustraits à une perquisition numérique.
4/ Enfin l’œuvre d’art frémit des réflexes du passé, qui nous reste en grande partie impénétrable : qu’il s’agisse d’une lumière assourdie, d’une religiosité contemplative, d’un jardin ensoleillé, d’une femme au bain, d’une Madone, il compte assez peu ou pas du tout qu’on y devine une sollicitation ironique ou érotique, mélancolique, parfois effarante ou troublante (comme la tête de Méduse en bouclier du Caravage et ses serpents ensanglantés, ou les vierges à l’Annonciation de Duccio qui font une moue attristée, à croire qu’une gestation pour autrui leur serait imposée) etc. L’inventaire de ses propriétés, à chaque fois, n’obéit jamais à un produit logique qu’on pourrait contenir dans une assertion bien construite.
L’avancée technologique et philosophique qui permet de parler de l’output phénoménologique des processus métacognitifs ne peut pas être contestée en tant que telle. C’est une avancée, en tant que telle captivante et féconde. Il faut ajouter cependant — c’est toute sa force démonstrative — que cette pénétrabilité cognitive qui fait que nos croyances peuvent affecter nos expériences perceptives, inclut la perception des absences, des pièges du contre champ, et gouverne les substitutions sensorielles dont la vue des citrons donne l’exemple, transformant une sensation tactile en un bénéfice optique.
En conclusion, si la fonction dépragmatisée de l’art peut être étudiée en dehors même de l’espèce artistique des êtres humains, n’est-ce pas précisément que — de par la stimulation de sentiments induits en nous et quelquefois inattendus —, ces produits de l’art demeurent des stimuli d’une variété différente ? J’entérine cette notion du stimulus proximal (pour parler en jargon) qui s’est effectivement imposée. Mais je ne le crois en aucune manière source de ces sentiments par une dynamique causale qui serait superstitieuse.
Je demeure fidèle à ces états qui requièrent la spontanéité de l’œil humain dans son intellection passive, pour ne pas succomber à l’illusion de la réceptivité d’un capteur oculaire chargé malgré lui d’informations qui ne le concernent pas.
Dernier exemple pour faire entendre que l'oeil n'est pas un capteur oculaire. J’en veux pour attestation, en effet, une capture mécanique et chimique : les exploits de Josef Sudek (1896-1976) dont les vues sont prises à Prague sous l’occupation dans les années Quarante : ils montrent des doubles fenêtres embuées et des photos en sous-verre, qui devraient rester un indice fort de la façon dont la précarité des photographies protège le sentiment que nous en formons de leur cause prochaine (ici la distribution de la lumière sur une surface vitrée). L’artefact issu de la chambre photographique et du tirage argentique dans l’œuvre de Sudek, n’est fondée que sur un sentiment « optique » qui n’a pas d’objet privilégié au sein de la distribution photonique et pour lequel nulle propriété graphique n’est photographiée.
16 juin 2022